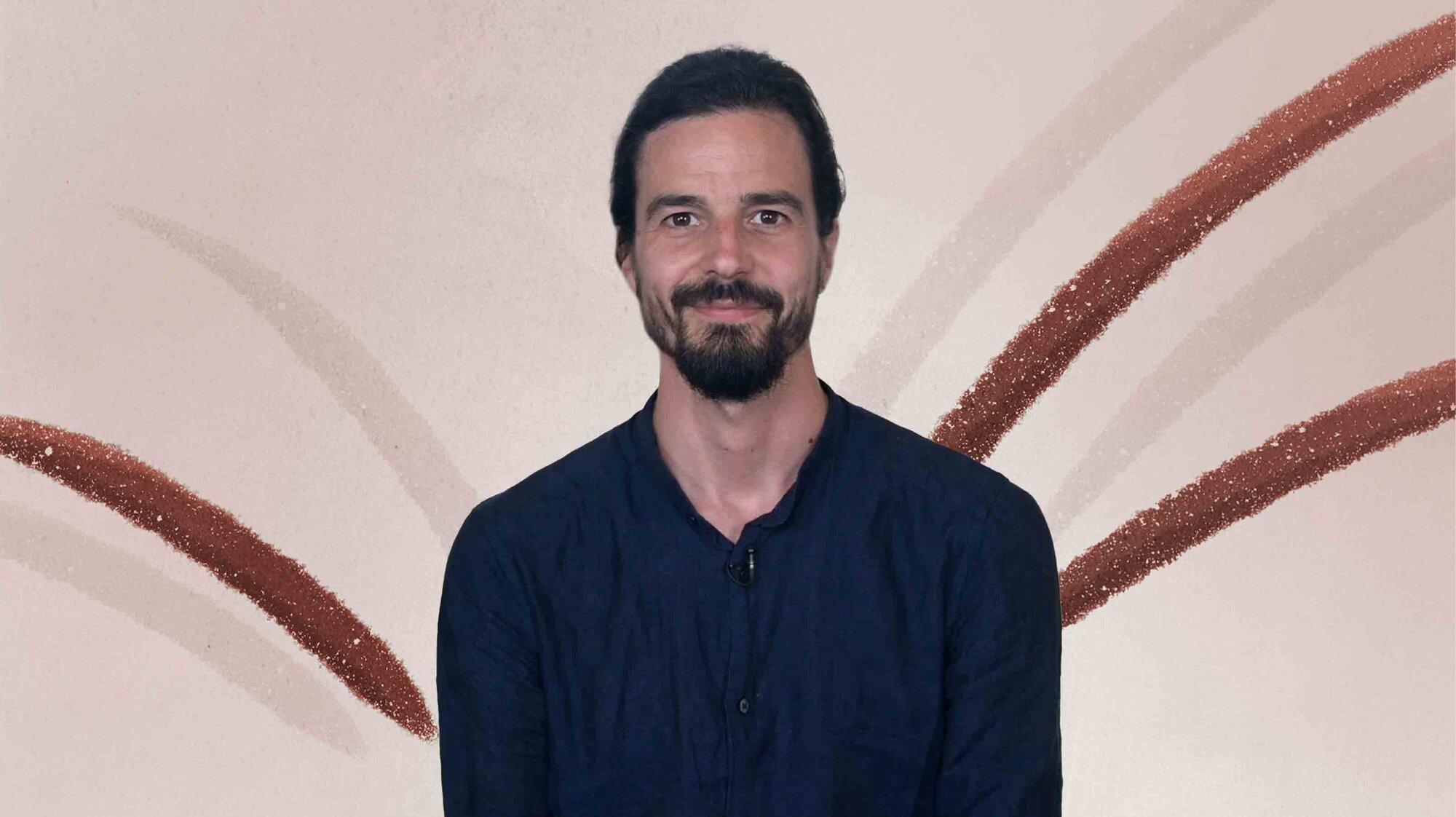Comprendre et déployer la force de l’entraide à toutes les échelles
Alors que la culture de la compétition nous fragilise socialement et nous fait perdre confiance en la nature humaine, cette masterclass propose un cadre opérationnel inédit, à la pointe de nombreuses recherches scientifiques, pour déployer la puissance de l’entraide à toutes les échelles de la société.

Leçons du Grand Cours 18épisodes
18
épisodes
- 1
De la nécessité de l’entraide
27 minPablo Servigne propose de nous embarquer dans ce cours avec une conviction forte : l’entraide est une force fondamentale, à la fois joyeuse, puissante et indispensable pour affronter les défis du XXIe siècle. Si le mot peut sembler désuet ou naïf, il recouvre en réalité une dynamique sociale et biologique essentielle. Dans ce premier épisode, découvrons la double ambitions du professeur avec ce Grand cours : proposer une synthèse scientifique sur l’entraide et construire un récit culturel alternatif au mythe dominant de la compétition.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre pourquoi l’entraide est une force puissante mais méconnue, capable de renforcer la résilience à toutes les échelles, du quotidien aux grandes crises
- Déconstruire le mythe de la compétition comme moteur du vivant, et découvrir les preuves scientifiques et biologiques de la coopération dans la nature et les sociétés
- Saisir les objectifs du Grand cours : changer notre vision du monde, comprendre les mécanismes de l’entraide, et poser les bases d’un projet de société plus juste et solidaire
- 2
L’entraide : de quoi parle-t-on ?
29 minDans ce deuxième épisode, nous explorons ensemble ce que recouvre la notion d’ « entraide ». En observant les comportements des humains, des animaux, des plantes et des micro-organismes, nous découvrons un monde tissé d’associations et de coopérations. Ce voyage au cœur du vivant nous invite à repenser notre place dans un monde interdépendant et à redonner ses lettres de noblesse à l’entraide comme principe fondamental.
Objectifs pédagogiques :
- Identifier la diversité des formes d’association dans le vivant, des symbioses biologiques aux comportements prosociaux humains, en passant par les coopérations animales et végétales
- Comprendre pourquoi le terme « entraide » est utilisé comme catégorie englobante, pour désigner un ensemble de dynamiques d'association omniprésentes dans la nature et dans nos sociétés
- Prendre conscience que l’humain est un être profondément interdépendant, structuré par de multiples niveaux d’entraide biologique, sociale et culturelle
- 3
L’entraide, une force invisibilisée
28 minDans cet épisode, nous retraçons les raisons historiques, philosophiques et scientifiques pour lesquelles l’entraide a été marginalisée dans notre culture et nos institutions. Nous mettons en lumière les mécanismes idéologiques qui ont conduit à l’invisibilisation de l’entraide au profit d’une glorification de la compétition. Nous aborderons un regard critique sur l’histoire des idées et réhabiliterons la pensée de Pierre Kropotkine, figure majeure de la théorie de l’entraide.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre comment l’idéologie de la compétition a été construite et diffusée, notamment à travers les sciences, l’économie et la pensée politique moderne
- Découvrir et réhabiliter la pensée de Pierre Kropotkine, qui a montré que l’entraide est un facteur central de l’évolution, aussi bien dans le vivant que dans les sociétés humaines
- Identifier les mécanismes historiques et politiques qui ont conduit à l’effacement des structures traditionnelles d’entraide, et comprendre les enjeux de leur reconstruction aujourd’hui
- 4
L’entraide en temps de crises
33 minEt si, face aux catastrophes, notre premier réflexe n’était pas la peur, mais la solidarité ? Dans cet épisode, nous explorons comment l’entraide émerge spontanément en situation de crise, révélant le potentiel collectif de nos sociétés. Ensemble, nous déconstruisons les idées reçues sur la panique et découvrons les conditions qui permettent à l’intelligence sociale de s’exprimer pleinement.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre que les catastrophes révèlent une tendance humaine spontanée à l’entraide, souvent ignorée par les récits médiatiques ou culturels dominants
- Identifier les conditions qui favorisent la résilience collective, comme les liens sociaux préexistants, la confiance et le sens donné à l’action collective
- Analyser comment les catastrophes favorisent la construction d’une identité sociale partagée qui transcende les différences de classe, de statut, de culture
- 5
Le don spontané
28 minSommes-nous naturellement égoïstes ou profondément solidaires ? Dans ce chapitre, nous explorons les fondements biologiques, psychologiques et sociaux de l’entraide spontanée. Ensemble, nous découvrons à quel point l’altruisme est un réflexe humain puissant, gratifiant, et profondément enraciné dans notre évolution.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre que l’entraide et l’altruisme sont des comportements spontanés, favorisés par l’intuition, le stress ou les émotions fortes, et observables dès la petite enfance
- Déconstruire le mythe de l’homo economicus, en s’appuyant sur des expériences qui montrent la propension naturelle des individus à coopérer sans intérêt immédiat
- Identifier les mécanismes cognitifs, biologiques et culturels qui favorisent ou affaiblissent la socialité humaine, notamment à travers la théorie des deux systèmes, l’heuristique sociale ou le rôle de l’environnement
- 6
La réciprocité au cœur de l’entraide
25 minDans cet épisode, nous plongeons au cœur de ce qui rend l’entraide possible et durable : la réciprocité. Ensemble, nous explorons ses racines biologiques, philosophiques et sociales, en découvrant comment elle structure nos liens, nos comportements et même nos sociétés.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre les bases biologiques et cognitives de l’empathie, et leur rôle central dans l’émergence de comportements réciproques
- Identifier les différentes formes de réciprocité dans les relations humaines et dans l’ensemble du vivant
- Analyser comment la réciprocité fonctionne comme une stratégie évolutive robuste
- 7
Renforcer la réciprocité au sein d’un gr...
35 minComment faire durer la coopération dans un groupe ? Dans ce chapitre, nous découvrons les mécanismes qui permettent de renforcer la réciprocité à grande échelle, depuis les récompenses et la réputation jusqu’aux normes sociales et aux institutions. Nous explorons ce qui rend la coopération possible — et fragile — dans nos sociétés.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre les mécanismes qui soutiennent ou affaiblissent la coopération dans un groupe
- Identifier le rôle central de la réputation et des normes sociales dans l’élargissement de la réciprocité au sein de grands groupes
- Analyser comment les institutions et les normes sociales peuvent permettre de stabiliser la coopération dans les grands groupes humains
- 8
Le concept de membrane
32 minEt si la clé d’un groupe coopératif et résilient résidait dans sa membrane ? Dans cet épisode, nous découvrons comment cette métaphore empruntée au vivant nous aide à penser les conditions d’un collectif sain, protecteur et ouvert à la fois. Nous apprenons à repérer, construire, renforcer et élargir ces membranes, pour tisser de meilleurs liens et renforcer l’entraide.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre le concept de membrane appliqué aux groupes humains, et ses fonctions clés : délimiter, protéger, identifier et favoriser la coopération
- Identifier les risques liés à une membrane mal définie ou imposée, ainsi que les conditions nécessaires à une co-construction saine et inclusive
- Explorer comment élargir notre membrane d’empathie, pour retisser du lien à soi, aux autres, et au reste du vivant et non-vivant
- 9
L’alchimie interne au groupe
29 minQu’est-ce qui fait qu’un groupe devient plus qu’une somme d’individus ? Dans cet épisode, nous explorons les ingrédients essentiels qui permettent à un collectif de basculer dans une dynamique d’entraide durable : la sécurité, la confiance et l’équité. Nous découvrons comment ces piliers invisibles transforment les relations et font émerger une véritable alchimie coopérative.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre l’importance du sentiment de sécurité comme condition préalable à la coopération
- Identifier les facteurs individuels, sociaux et biologiques qui favorisent la construction de la confiance au sein d’un groupe
- Analyser comment la perception d’équité influence la cohésion sociale et la durabilité des dynamiques d’entraide
- 10
Les forces extérieures et l'égrégore
28 minAprès avoir exploré les mécanismes internes qui favorisent l’entraide dans un groupe, ce chapitre se concentre sur les forces extérieures qui viennent « cuire » ces ingrédients. Ces leviers externes permettent à un groupe de franchir un seuil critique de cohésion et de solidarité. À ces dynamiques s’ajoute la possibilité d’un phénomène émergent : l’égrégore, ou mode « super-organisme ». Nous explorerons les promesses et les risques de cette force sociale fascinante.
Objectifs pédagogiques :
- Identifier les principales forces extérieures qui renforcent la cohésion et l’entraide dans un groupe
- Comprendre le phénomène d’égrégore ou de “mode abeille”, où un groupe humain fonctionne temporairement comme un super-organisme
- Analyser l’ambivalence du mode abeille, capable du meilleur comme du pire
- 11
L’entraide entre les groupes
30 minAprès avoir exploré les mécanismes de l’entraide à l’intérieur des groupes, ce chapitre aborde la question fondamentale de l’entraide entre groupes. Quelles sont les les conditions — psychologiques, structurelles et culturelles — qui rendent possible l’entraide entre groupes humains, qu’il s’agisse de pays, d’entreprises ou de civilisations ? Ensemble, nous réfléchissons aux limites de la coopération mondiale et aux chemins pour la réinventer, face aux défis du XXIe siècle.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre comment les mécanismes de l’entraide peuvent être transposés à l’échelle intergroupe
- Analyser les freins à la coopération mondiale
- Identifier les conditions d’une coopération durable à grande échelle
- 12
L’entraide au quotidien
36 minComment faire de l’entraide une pratique concrète, vivante et quotidienne ? Dans cet épisode, nous plongeons dans des exemples concrets issus de la vie familiale, de l’éducation et du jeu, pour comprendre comment instaurer des environnements qui favorisent la coopération dès l’enfance. Ce chapitre est une invitation à comprendre que cultiver l’entraide au quotidien, c’est déjà transformer profondément notre société.
Objectifs pédagogiques :
- Identifier les leviers concrets qui permettent de cultiver l’entraide dans la sphère familiale, notamment par l’écoute, la médiation, la coopération et l’exemplarité adulte
- Analyser comment les pratiques issues des peuples premiers et des pédagogies alternatives favorisent une culture de la coopération dès l’enfance
- Comprendre le rôle du jeu coopératif et de la relation à la nature comme espaces d’apprentissage de la confiance, de la régulation émotionnelle et de l’interdépendance
- 13
De meilleures organisations
32 minAprès avoir exploré l’entraide au sein de la famille, de l’éducation et des jeux coopératifs, ce chapitre franchit une nouvelle échelle : celle des organisations. Comment créer des structures collectives qui favorisent le lien, la confiance et la coopération ? Embarquons dans le parcours progressif que nous propose Pablo, en 3 niveaux inspirés des pistes de ski (vert, rouge, noir), pour densifier les liens sociaux au sein d’un collectif.
Objectifs pédagogiques :
- Identifier les trois niveaux relationnels permettant de renforcer la cohésion dans une organisation, du lien informel (piste verte) à l’épreuve commune (piste noire)
- Comprendre les principes structurants des organisations “Opale” et les leviers concrets d’une culture d’entraide, en opposition aux logiques hiérarchiques, concurrentielles et fragmentées
- Explorer les modèles inspirés du vivant et les principes de la permaculture comme cadres éthiques et systémiques pour concevoir des organisations durables et adaptatives
- 14
Une arme pour lutter et se défendre
28 minAu fil du temps, l’entraide est devenue et perdure à ce jour comme une véritable force de résistance, de survie et de transformation sociale. Dans cet épisode, nous explorons les formes d’entraide qui permettent de faire face à l’oppression, d’inventer des alternatives et de bâtir des collectifs puissants et justes.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre comment l’entraide a historiquement permis à des groupes opprimés de résister, survivre et construire des formes d’organisation autonomes
- Identifier les principes politiques et sociaux qui structurent une culture d’entraide radicale, notamment dans les mouvements militants contemporains
- Faire le lien entre entraide, création d’alternatives concrètes et transformation culturelle profonde, comme piliers d’un changement de société durable
- 15
Un outil pour prendre soin et construire
30 minNous prolongeons ici la réflexion amorcée dans l’épisode précédent en explorant une autre facette essentielle de l’entraide : sa capacité à bâtir, à soigner, à structurer des communautés résilientes et équitables. À travers une réflexion nourrie d’exemples, de concepts politiques et de principes issus de la gouvernance des communs, Pablo propose un véritable cadre de pensée pour concevoir des alternatives concrètes aux modèles dominants. Loin d’être une simple vertu morale, l’entraide devient ici un outil politique puissant pour repenser l’économie, les institutions, la démocratie et les relations humaines.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre comment l’entraide peut servir à construire des alternatives politiques, économiques et sociales fondées sur l’autonomie, l’équité et la solidarité
- Identifier les risques de dérives ainsi que les conditions à mettre en place pour encadrer à la fois la compétition et l’entraide
- Découvrir les principes de gouvernance des communs d’Elinor Ostrom et leur applicabilité dans de nombreux domaines, de la gestion des ressources naturelles aux services publics ou aux environnements numériques.
- 16
L’évolution de l’entraide
33 minPlace à l’exploration des origines évolutives de l’entraide, en interrogeant ses racines profondes dans le monde vivant. Embarquons pour une traversée dans le temps long de l’évolution biologique et culturelle pour comprendre comment la coopération, l’altruisme et l’interdépendance ont pu émerger, se consolider, puis devenir des stratégies adaptatives majeures. À travers des études scientifiques, des expériences biologiques et des réflexions anthropologiques, nous démontrerons que l’entraide est non seulement un comportement hérité, mais aussi un facteur clé de survie pour de nombreuses espèces, y compris l’espèce humaine.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre que l’entraide est une stratégie évolutive robuste, ancrée dans les dynamiques du vivant
- Identifier les multiples forces qui favorisent l’apparition de la coopération, telles que la sélection de parentèle, la sélection spatiale, la sélection de groupe ou les contextes écologiques contraignants
- Reconnaître que l’environnement joue un rôle décisif dans l’émergence des comportements sociaux et que la coopération peut être vue comme une réponse collective à l’adversité
- 17
Un principe du vivant
33 minDans ce chapitre, nous exposons une idée fondatrice : l’entraide ne se limite pas aux comportements humains, mais constitue un principe fondamental du vivant. En s’appuyant sur des observations écologiques et des expériences scientifiques issues de multiples disciplines (botanique, microbiologie, biologie évolutive…), nous démontrons que la coopération entre organismes – y compris entre espèces différentes – est non seulement fréquente mais également essentielle à l’évolution, à la survie et à l’innovation du vivant. Ce chapitre approfondit l’intuition du penseur Pierre Kropotkine : dans les milieux hostiles, la solidarité devient un levier adaptatif puissant.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre que l'entraide est un mécanisme évolutif majeur dans le monde vivant, favorisé par des conditions environnementales hostiles et observable à toutes les échelles du vivant, des microbes aux super-organismes
- Identifier les processus d’innovation biologique liés à l’entraide, tels que la contagion coopérative, la symbiogenèse et la montée en complexité, qui ont permis à la vie d’évoluer vers des formes toujours plus sophistiquées
- Intégrer l’idée que la coopération structure le vivant autant, voire davantage que la compétition, et que dans un contexte de crises à venir, c’est cette dynamique d’entraide qu’il nous faut aujourd’hui renforcer dans nos sociétés
- 18
De l’anthropocène à la symbiocène
27 minDans ce dernier épisode, nous concluons notre exploration de l'entraide en élargissant la perspective aux enjeux civilisationnels et écologiques actuels. Nous envisageons un changement de paradigme profond : passer de l’Anthropocène, époque marquée par la domination humaine destructrice sur la nature, à une ère nouvelle que Pablo Servigne nomme, avec Glenn Albrecht, la Symbiocène – une ère fondée sur la coopération et l’interdépendance entre les êtres humains et le vivant. Ce chapitre constitue à la fois une synthèse, un manifeste et une invitation à poursuivre le chemin de l’entraide.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre les principes fondateurs de la Symbiocène : une ère alternative à l’Anthropocène, structurée autour de l’interdépendance et d’une économie régénérative
- Identifier les freins et les dérives des institutions modernes : en reconnaissant comment l’entraide a été historiquement invisibilisée ou détournée, et en explorant les conditions pour la réhabiliter comme force politique et sociale
- Adopter une perspective élargie de l’empathie et de la coopération : en étendant ces principes au non-humain, et en cultivant des environnements favorables à l’altruisme, au soin et à la cohabitation avec le vivant
La culture de la compétition généralisée est devenue toxique pour la société et pour la biosphère. Elle constitue un verrou majeur pour bâtir des sociétés plus saines, pacifiées, sensées et équilibrées. Il est toutefois possible de faire sauter ce verrou en s’intéressant aux manières qu’ont les êtres vivants de s’associer.
L’entraide est une force horizontale qui rapproche les gens, qui a toujours existé, et dont nous avons toujours besoin.
Face
Durée du cours: 18 leçons vidéos (9 h)
Catégories: Adaptation et systémique
Ce que je vais apprendre dans cette formation
Comprendre les mécanismes de l’entraide humaine
Découvrir les différentes manières qu’ont les êtres vivants de s’associer
Cerner les inconvénients et les avantages de la compétition
Acquérir une meilleure vision de la nature humaine, et de la nature en général
Comprendre ce qui se joue socialement lors d’une catastrophe
Comprendre le caractère profondément ultrasocial de l'espèce humaine
Apprendre à favoriser la coopération dans une organisation pour améliorer son efficacité sociale et sa robustesse
Nos autres grands cours
Adaptation et systémique
Chargement...
Nos autres mentors
Les professeurs
Sator
Chargement...
Questions fréquentes
Formez vous avec Sator, montez en vision et en compétences
Développez les compétences stratégiques de vous ou de vos collaborateurs grâce à nos formations captivantes et faciles à déployer.