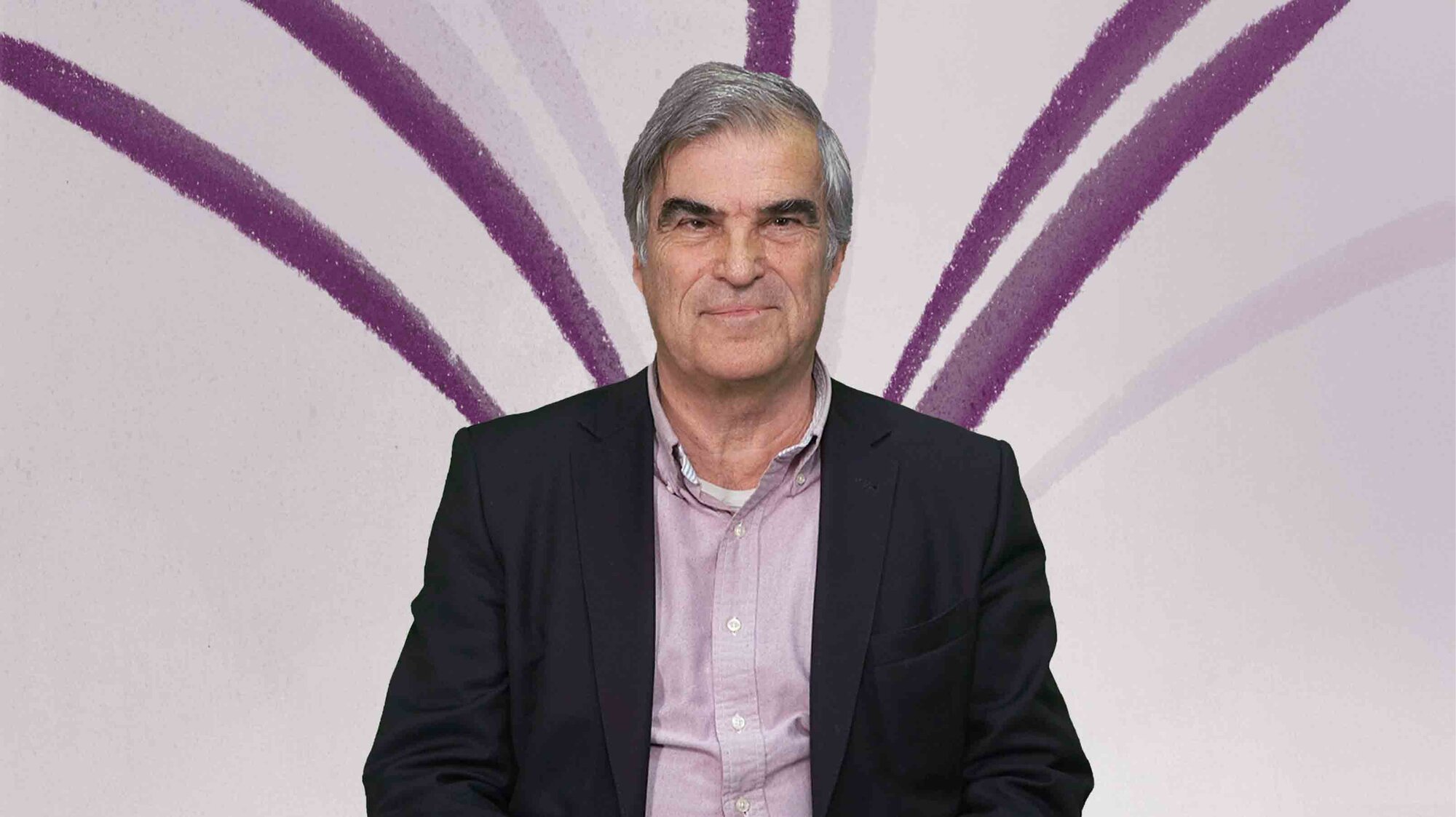Comprendre les enjeux juridiques d'aujourd'hui grâce aux récits
État de droit, dictature, justice, désobéissance civile... le droit est partout : il régit par des contrats notre existence et notre rapport aux autres. Découvrez différemment le droit grâce aux récits, en compagnie de François Ost, à la fois juriste, philosophe, écrivain et dramaturge.

Leçons du Grand Cours 18épisodes
18
épisodes
- 1
Face aux défis contemporains, qu’attendr...
31minQu’est-ce que le droit : un ordre normatif contraignant et autonome, ou bien un produit culturel, résultant des rapports de force qui prévalent dans la société ? Quelles finalités poursuit-il ?
Les acquis de l'épisode
- Saisir la place du droit dans la société, entre éthique et politique
- Comprendre les finalités poursuivies par le droit
- 2
Droit et littérature - Pourquoi une appr...
30minRaconter le droit pour le comprendre mieux, en le mettant en contexte, permet de le saisir comme un objet culturel et pas seulement un ensemble de normes. Quelles sont les convergences et les divergences entre droit et littérature, norme et récit ?
Les acquis de l'épisode
- Comprendre en quoi le droit est le produit d’une culture donnée
- Maîtriser les différences entre droit de la littérature, droit dans la littérature, droit comme littérature et droit par la littérature.
- Comprendre la plus-value d’une approche narrative du droit
- 3
Quel droit pour quelle société ? Introdu...
28minRéunis en conseil par Noé, les animaux délibèrent : faut-il du droit pour régler leur cohabitation ? Et si oui, quelle sorte de droit : détaillé et sévère, ou général et tolérant ? Et la justice qui applique ce droit, quelle part doit-elle réserver à l’équité ? Un récit juridique original de François Ost.
- 4
Droit naturel, droit positif - Un débat ...
30minSi nous étions, nous aussi, comme les animaux de l’Arche, confinés dans un endroit clos pour une durée indéterminée, déciderions-nous de nous doter de règles juridiques et d’organes pour les mettre en œuvre ? Cette question, qui est celle du contrat social, a reçu des réponses bien différentes, selon les époques et les courants philosophiques. Que choisirions-nous aujourd’hui ?
Les acquis de l'épisode
- Maîtriser la dialectique entre droit naturel et droit positif
- Connaître les grandes figures historiques de la théorie du droit
- Comprendre la tension entre droit de propriété et bien commun
- 5
Au commencement était la loi - La loi da...
30minDans nos pays dits de « droit codifié », par opposition aux pays de common law, le droit s’identifie d’abord au droit écrit, législatif et étatique : loi, Constitution, règlements. À l’époque des Lumières, la loi a fait l’objet d’un véritable culte, et les codifications napoléoniennes ont diffusé le modèle du code dans l’Europe entière. Que faut-il pour qu’une nation se dote de lois générales et justes, et s’y conforme ?
Les acquis de l'épisode
- Comprendre les raisons, et les critiques, du culte de la loi
- Cerner les rapports entre contenu et réception de la loi
- Maîtriser les liens entre démocratie et hétéronomie de la loi
- 6
Le Sinaï, ou l’apprentissage de la loi
30minL’analyse du texte de la Genèse, connu sous le nom de « donation de la loi au Sinaï », permet d’approfondir la question des conditions de possibilité de la loi. Ce récit recèle bien des surprises : la loi dépend au moins autant de l’autonomie d’un peuple qui se libère que de l’autorité d’un législateur qui s’impose. L’important est moins le contenu de la loi - ce qu’elle ordonne ou interdit - que les conditions qui prédisposent à la recevoir et la respecter.
- 7
Juger, venger, pardonner : Trois manière...
30minLe moment juridique vraiment fondateur est celui où les hommes renoncent à se faire justice à eux-mêmes et remettent le règlement de leurs contentieux à un tiers impartial. Ce moment s’est étalé sur des siècles, voire des millénaires, pour se concrétiser dans l’institution des Cours et tribunaux que nous connaissons aujourd’hui. Mais alors, quelle est la spécificité de l’acte de juger par rapport à la vengeance et au pardon ?
Les acquis de l'épisode
- Maîtriser la différence entre justice privée et justice publique
- Connaître la symbolique du droit – la balance, le glaive et le bandeau
- Comprendre les différentes fonctions du jugement
- 8
Juger, venger, pardonner : Trois manière...
31minLa vengeance est pré-juridique et confie le règlement du tort à la victime ou sa famille ; le pardon est post-juridique et suppose une miséricorde qui ne se préoccupe plus d’équivalence. Entre violence et amour, la justice instituée impose le tiers impartial. La balance la symbolise, entre le glaive (violence) et le bandeau (amour). De nombreux récits de fiction illustreront ces divers cas de figure.
Les acquis de l'épisode
- Mesurer l’importance de la psychologie dans l’élaboration et la réception du droit
- Comprendre les liens et les différences entre juger, venger et pardonner
- 9
L’Antigone de Sophocle, modèle de toutes...
30minDe tout temps, des femmes et des hommes courageux ont opposé les exigences de leur conscience à la « raison d’État », qui est parfois une « déraison d’État ». L’Antigone de Sophocle en est, aujourd’hui encore, l’archétype littéraire inégalé. Son histoire est réécrite à chaque génération, en écho aux combats du moment. Quelles lectures est-il possible d’en donner aujourd’hui ?
- 10
La désobéissance civile, hier et aujourd...
31minAprès en avoir évoqué quelques exemples célèbres (Thoreau, Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks), comment peut-on distinguer la désobéissance civile militante de la désobéissance criminelle, mais également d’autres formes de résistance (dissidence, objection de conscience, révolution). Pourquoi, en démocratie, la loi bénéficie-t-elle d’une présomption de légitimité, et pourquoi - et à quelles conditions - est-il cependant légitime de lui désobéir dans certaines circonstances ?
Les acquis de l'épisode
- Comprendre ce qu’est et n’est pas la désobéissance civile, et évaluer les raisons d’obéir ou de désobéir à la loi
- Découvrir des figures historiques de la désobéissance civile
- Maîtriser la dialectique entre démocratie et désobéissance civile
- 11
L’État de droit à l’épreuve des crises r...
30minQuelles est la genèse de L’État de droit et les évolutions que la notion a connues depuis sa naissance en Allemagne au XIXe siècle ? L’évocation précise de divers épisodes liés à la crise du Covid-19 ou d’autres crises récentes permettra de mieux cerner ses contours et notamment de le différencier de diverses figures qui, à cette occasion, en ont altéré les traits : État social, état d’urgence ou encore l’état de nécessité, voire l’état d’exception.
Les acquis de l'épisode
- Maîtriser la définition progressive de l’État de droit dans l’Histoire
- Maîtriser la différence entre état providence, état d’urgence, état d’exception, état de nécessité
- 12
L’État de droit à l’épreuve des crises r...
30minSi on considère que les notions de légalité, de stabilité et de généralité constituent les trois piliers de l’État de droit, comment ces trois exigences résistent-elles aux notions opposées de nécessité, d’urgence et d’exception qui sont invoquées en période de crise ? Ce fut le cas lors de la pandémie, et cela pourrait bien encore être le cas demain, en cas de crise écologique, sanitaire ou militaire majeure.
Les acquis de l'épisode
- Comprendre le problème du relâchement général du principe de légalité
- Saisir la différence entre Rule of law et Rule by law
- 13
3,2,1 … L’Amérique juridique selon D.Tru...
32minCe conte original de François Ost évoque, sur le mode de la dystopie, la régression profonde que la présidence de D. Trump a imposée au droit des États-Unis durant les quatre années de son mandat. En un mot : la régression du droit « tiers » au face-à-face du rapport de force personnel, qui entraîne finalement l’hégémonie du plus fort.
- 14
Le droit ou l’empire du tiers
32minPour les sociétés qui « passent au droit », la plus-value est d’inscrire la relation sociale primaire (familiale, économique, politique) sur une scène « autre », symbolique, qui est celle du tiers, en instituant le monde « secondaire » des institutions et des règles juridiques. Que veut dire cette instance « tierce », et quelles en sont les principales traductions juridiques, l’État de droit notamment ?
Les acquis de l'épisode
- Déterminer la présence ou l’absence d’un tiers juridique
- Découvrir différents exemples historiques de tierciarisation
- Connaître les quatre étapes du processus de tierciarisation
- 15
Un droit pour la nature ? Le naufrage de...
32minCe récit, qui prend la forme d’un thriller maritime réaliste, démontre le caractère non naturel de ce naufrage, largement causé par les tergiversations juridiques de l’armateur américain, réticent à faire remorquer le pétrolier en détresse, et le scandale que représente le système des « pavillons de complaisance ». Ce récit montre aussi la résistance des maires bretons qui demanderont justice jusqu’à Chicago et contribueront ainsi, pour la première fois, à faire reconnaître la notion de « préjudice écologique ».
- 16
Le contrat juridique planétaire, une uto...
32minAu bénéfice de quelques décennies de droit de l’environnement, un bilan prospectif peut-être tenté. Quels sont les instruments juridiques les plus aptes aujourd’hui à favoriser la transition écologique ? La personnification de la nature, la généralisation de la notion de « biens communs », l’approfondissement de nos responsabilités et le développement des actions en justice, climatiques notamment ? Quid d’une refondation du contrat social classique qui prendrait aujourd’hui la forme d’un contrat social planétaire.
Les acquis de l'épisode
- Maîtriser les 7 caractéristiques du Contrat social
- Maîtriser la transposition de ces 7 caractéristiques au Contrat social planétaire
- Évaluer la pertinence des différents instruments juridiques possibles pour une transition écologique effective
- 17
Un monde sans droit ? Dystopies littérai...
32minLe siècle dernier aura connu les pires catastrophes politiques. La littérature les a anticipées et accompagnées. On discutera, parmi d’autres, Le zéro et l’infini (A. Koestler), Le meilleur des mondes (A. Huxley), et 1984 (G. Orwell). Le droit nazi en aura été, hélas, une bien réelle concrétisation. Étudier ses ressorts permet, a contrario, de mieux saisir ce que le droit devrait être.
Les acquis de l'épisode
- Découvrir le rapport au droit décrit dans plusieurs grandes œuvres littéraires dystopiques du XXe siècle
- Connaître les fondements du droit nazi
- 18
Sade et Kafka, le droit mis à mal
30minMême s’ils ont très différents, Sade et Kafka traduisent, tantôt un rejet violent du droit commun, tantôt une angoisse radicale face à ce qui est ressenti comme l’absence de droit. Dans les deux cas, le « il » du tiers juridique est absent. En creux, ces modèles anti-juridiques font percevoir la valeur d’une culture juridique fondée sur l’acceptation commune du tiers.
Les acquis de l'épisode
- Comprendre les liens entre perversion et dénaturation du droit
- Comprendre les risques de la disparition du tiers
Le droit est partout. Il encadre tous les aspects de notre vie quotidienne et oriente la vie collective de façon décisive. Pourtant, il est mal connu et mal aimé ; déprécié pour son jargon et son formalisme, redouté pour ses sanctions et ses contraintes.L’ambition de cette masterclass du juriste et philosophe François Ost est de renverser ces préjugés. Faire comprendre le rôle irremplaçable joué par le droit dans l’approche éthique, l’analyse politique, et in fine la construction du lien social.
Comment le droit a-t-il pacifié les civilisations, ou au contraire, comment le recul du droit a ouvert la voie aux
...afficher plusDurée du cours: 18 leçons vidéos (10h)
Catégories: Softs skills de demain
Ce que je vais apprendre dans cette formation
Savoir définir le droit et ses différentes finalités
Connaître les grandes visions du droit qui s’opposent dans l’histoire
Évaluer la place du droit entre éthique et politique et maîtriser les différences entre droit naturel et droit positif
Appréhender les risques liés au recul du droit, ainsi que les raisons d’obéir et de désobéir à la loi
Maîtrisez les contours de l’état de droit et du contrat social
Comprendre le phénomène de tierciarisation des sociétés
Penser les bases du contrat social planétaire
Nos autres grands cours
Softs skills de demain
Chargement...
Nos autres mentors
Les professeurs
Sator
Chargement...
Questions fréquentes
Formez vous avec Sator, montez en vision et en compétences
Développez les compétences stratégiques de vous ou de vos collaborateurs grâce à nos formations captivantes et faciles à déployer.